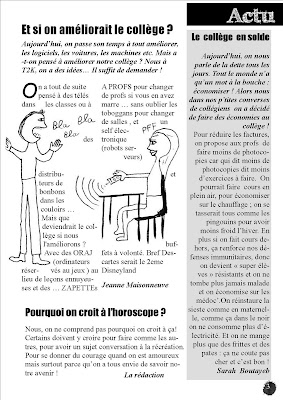Vous pouvez le télécharger en pdf en cliquant sur ce lien ;
mercredi 30 novembre 2011
lundi 28 novembre 2011
A lire dans l'âge de Faire n°59 la " fabriquer des peintures végétales"
Si tu aimes l'art, les travaux manuels et les balades dans la nature : il ne faut par rater l'article paru page 20 dans le journal l'âge de faire n°59 : " fabriquer des peintures végétales" : on obtient des peintures à partir de nombreuses plantes : il suffit de presser les végétaux (baies de troène, épinards, betteraves...) et parfois de les faire cuire. Non toxiques, ces peintures peuvent être fabriquées avec tes petits frères et sœurs.
dimanche 27 novembre 2011
Compte rendu du débat sur l'autorité des professeurs
Le sujet est proposé par les
élèves en classe journalisme après le fait divers sur une professeure en
souffrance qui s’était immolée devant les élèves à la récréation : ils avaient
envie de parler de ces profs en difficulté.
Un cours qui se passe
mal niveau de la discipline, c’est quoi ?
Garçon, 6ème : « C’est quand il y a des
perturbateurs qui empêchent le prof de faire son cours ».
Elisa : « C’est quand le prof n’a pas d’autorité
et laisse faire les élèves ».
Garçon, 6ème : « Parfois, il y a des
conflits entre élèves qui ne s’entendent pas dans la classe ».
Thomas : « Parfois, les perturbations peuvent
venir de l’extérieur, quand des élèves toquent à la porte ».
Lucas : « Il y a aussi, des élèves qui peuvent
entrainer les autres, en les faisant rire etc».
Au niveau du
prof ?
Ruben : « C’est un prof qui ne réagit pas, qui ne
donne pas de punition ».
Eva : « C’est les profs qui ne savent pas se faire
écouter et qui continuent quand même leurs cours ».
Karen : « C’est un prof qui ne donne pas de
limites claires à ses élèves. Il donne trop de droit à ses élèves ».
Comment un prof peut
faire pour imposer son autorité ?
Garçon, 6ème : « Il peut marquer le nom
des punis au tableau et donner des heures de colles ».
Emeric : « Il faut qu’il soit clair dès le début
de l’année, il ne doit pas accepter certaines choses des élèves ».
Garçon, 6ème : « Il doit savoir élever
la voix ».
Lucas : « C’est dès le début de l’année que ça se
passe, il doit être très ferme au début. Il doit s’imposer aux élèves».
Karen : « Il doit savoir montrer sa colère, son
irritation dès qu’il sent que les élèves lui échappent ».
Garçon, 3ème : « Il y a des profs qui
ne donnent jamais d’heures de colle et ça se passe bien dans leur classe.
Ils n’en ont pas besoin ».
Xavier : « Il
faut que les profs instaurent une relation de confiance avec leur élèves. Une
sorte d’intérêt commun entre le prof qui est
meilleur si le cours se passe
bien, et les élèves qui ont besoin de
lui pour avancer ».
Elisa : « C’est du donnant, donnant, quand les élèves
sont attentifs et participent le prof à plus envie de faire cours avec les
élèves et on s’ennuie moins ».
C’est quoi avoir de
l’autorité ?
Garçon 5ème : « C’est un prof qui sait
se faire comprendre et qui fait des cours de qualité ».
Charlyne : « Il y a aussi l’apparence qui
compte : s’il n’a pas l’air joyeux ».
L’autorité ça
s’apprend ou c’est en nous ?
Lucas : « L’autorité, c’est naturel ».
Garçon 5ème : « C’est vrai, il y a des
personnes plus douées que d’autres dans ce domaine ».
Karen : « Il y a des profs qui aiment trop les
enfants, ils sont trop doux ».
Charlyne : « On détecte vite un prof qui n’a pas
d’autorité, on en profite ».
Est-ce que c’est
naturel que dès qu’un élève n’est pas surveillé, il en profite ?
Lucas : « Par exemple, avec les profs stagiaires,
ils sont facilement déstabilisés, alors on profite ».
Lucas R. : « Au contraire, comme ils débutent on devrait
les aider à se faire respecter pas les enfoncer, sinon, à peine commencer, ils
vont se mettre à détester les élèves.
Mais il faudrait que tous les élèves le veuillent ».
Que pense le prof
quand ça se passe mal ?
Karen « : « Il pense qu’il ne sait pas faire,
qu’il n’est pas fait pour ce métier ».
Garçon 5ème : « Il pense que c’est
de la faute des élèves ».
Marielle : « Il s’en fiche un peu, il pense que
les élèves s’en sortiront pas plus tard ».
Garçon 5ème : « Les profs qui
n’ont pas d’autorité, ça vient d’eux et ça vient des élèves ».
Fille 6ème : « Ils se disent que ça
sera mieux l’année prochaine ».
Garçon 4ème : « Les profs, il s n’ont
pas le droit de se dire ça, les profs, leur but c’est d’aider tous les élèves, ils sont
responsables de nous, ils ne doivent pas renoncer à l’autorité ».
Elisa : « C’est un peu un cercle vicieux :
quand un prof n’a pas d’autorité, il a moins confiance en lui, et comme il n’a
moins confiance en lui, il a encore moins d’autorité ».
Que penser des
punitions ?
Yannick : « Les punitions, ça dépend des élèves,
pour que ça marche, il faut que l’élève ait peur ».
Lucas : « ça peut jouer, si ensuite on se fait
engueuler par nos parents. Elle doit
être ressentie comme une chose grave».
Garçon 5ème : « La punition ce n’est
pas la bonne méthode pour les élèves qui s’en fichent ».
Garçon 6ème : « Si le prof ne
donne jamais de punition il n’aura pas d’autorité, s’il en met trop, ses
punitions ne seront plus prises au sérieux ».
Charlyne : « Si un prof met une heure de colle à un élève, l’élève le déteste
encore plus et ça ne risque pas de s’arranger entre eux. La punition, quand
elle n’est pas acceptée peut envenimer les choses ».
Xavier : « Quand un prof a de l’autorité il n’a
pas besoin de donner des punitions. »
Garçon 5ème : « Une punition, ça sert à
nous faire reconnaitre qu’on a fait une faute. Elle est utile que si elle nous
oblige à respecter le règlement ».
Charlyne : « Les profs ils n’aiment pas donner des
punitions parce que ça leur fait du travail en plus ».
Garçon 6ème : « Parfois, il faut changer les
règles, par exemple l’interdiction des portables ça ne sert à rien. Si il y a
trop de règles qui ne sert à rien, ça crée des conflits ».
Jacques : « Mérieux, penseur en éducation
dit : « l’autorité ce n’est pas avoir la paix pour un prof. L’autorité ça doit permettre aux élèves
de vivre en paix ».
Elisa : « Il y a des prof, pour qui un bon p’tit
coup de gueulante suffit ».
Pour restaurer
l’autorité des profs on parle des certaines mesures, qu’en pensez-vous ?
L’uniforme :
« Ça restreint notre liberté d’expression, notre
liberté individuelle, car par nos vêtements, on dit quelque chose de nous ».
« Grâce à l’uniforme on peut éviter des moqueries sur
nos vêtements, ça peut éviter des conflits ».
« Ça pourrait éviter la vulgarité ».
« Mais on pourrait quand même montrer notre
caleçon ».
« Dans un uniforme on pourrait se sentir mal dans notre
peau ».
Rester debout :
« C’est une marque de respect »
« C’est bien de se mettre debout parce qu’on n’est pas
obligé de dire bonjour au prof et c’est plus pratique pour sortir ses
affaires ».
« On n’est pas des animaux : assis, debout,
assis… c’est du dressage ».
Obliger le
vousoiement des profs et des élèves
« Quand un prof
vouvoie un élève, on l’impression qu’il parle à toute la classe »
« C’est une marque de respect »
« Ça peut marquer une certaines égalité, mais on
pourrait aussi tous se tutoyer ».
« C’est une marque de respect entre élèves et adultes.
Mais un prof qui me vouvoie ce n’est pas pour ça qu’il me respecte plus qu’un
prof qui me tutoie ».
« Quand un prof nous vouvoie, on ne se sent pas à
l’aise. Le tu c’est plus chaleureux. Le vous c’est un peu artificiel ».
« Ça fait un peu coincé, ça fait j’ai peur des élèves
en mettant de la distance ».
« Le vous c’est pour les personnes qui ne sont pas
proches »
« Le vous envers le prof c’est une marque de
respect »
« On est habitué comme ça, parce qu’en primaire on peut
tutoyer sa maitresse et ça se passe bien ».
mardi 22 novembre 2011
vendredi 18 novembre 2011
Compte rendu café philo sur le cannabis
Cannabis : légaliser ou changer la législation, c’est
une des questions à laquelle les
candidats des présidentielles vont devoir se prononcer. C’est aussi une
question, proposée par des élèves de la classe journalisme.
C’est quoi le cannabis ?
C’est une la tête d’une
plante, séchée qui contient des doses plus ou moins forte de THC, une substance
psychotrope.
Quels pourraient être les arguments pour la légalisation du
cannabis ?
David : « pour boucher le trou de la sécurité
sociale, comme pour le tabac et l’alcool, si c’est fortement taxé on récupère
plein d’argent pour remplir les caisses de l’Etat ».
Qu’est qu’une drogue pourquoi ça peut être interdit ?
François : « Une drogue, c’est quelques qui nous
détruit, qui nous entraine dans la dépendance, on ne peut plus s’en
passer ».
Antoine : « Une drogue c’est tout ce qui rend
dépendant ; la drogue ça peut être du café, de l’alcool du tabac, du
chocolat, les jeux, les drogues dures… »
Laurent : « Une drogue c’est un produit, non
nécessaire au corps et qui produit de la dépendance ».
Pourquoi l’alcool est légal et pas le cannabis ?
Thomas : « il ne faut pas légaliser les drogues
parce que ce sont des produits dangereux »
Xavier : « mais si on légalise, on contrôle la
qualité du produit, donc c’est moins nocif pour les consommateurs ».
Antoine : « C’est plus naturel que le tabac, le
cannabis, il n’y a pas de goudron ou des produits chimiques, donc il faudrait
le légaliser, mais en interdisant la consommation au moins de 18 ans et vendre
que des petite doses et faire de la prévention ».
Maxime : « Avec la vente des cigarettes, il y a
des messages et des images, ça donne envie parfois d’arrêter".
Jacques : « Je ne suis pas d’accord, car ce qui
c’est passé pour les cigarettes a prouvé
que la prévention, l’augmentation des
prix, les campagnes d’information, les
images chocs n’ont pas fait baisser la consommation des cigarettes, surtout
chez les jeunes ».
Que pensez-vous de l’alcool en vente libre ?
François : «C’est une tradition, en France, on
ne pourra jamais l’interdire »
Séverine : « La France est également un gros
producteur d’alcool, ça génère de l’emploi, de l’argent…etc.… »
Laurent : « La prohibition dans les années 20, aux
Etats-Unis a prouvé son inefficacité. L’alcool était encore plus dangereux car
fait dans des conditions artisanales avec des alcools très forts ».
Drogue et argent
François : « Les ados s'ils en veulent, ils en
trouvent et pour les problèmes d’argent, s’ils n’ont pas d’argent, ils peuvent
toujours en vendre un peu pour pouvoir d’acheter du cannabis pour ta consommation
personnelle ».
Si tu étais parent, laisserais-tu tes enfants fumer du
cannabis ?
Antoine : « Je crois, que ça me rassurerait de
savoir que mes enfants fument du cannabis légalement et l’achètent dans des
boutiques, plutôt qu’à des trafiquants ».
La motivation de fumer ?
François : "C’est pour être bien en soirée, pour draguer
plus facilement ».
Antoine : "C’est pour être dans un autre état, par
comme d’habitude ".
Un sixième : "ça ne sert à rien, et en plus c’est
mauvais pour toi ».
Valentin : « On peut avoir l’impression d’entendre
mieux la musique ».
Antoine : « ça permettrait à des pays plus pauvres
de se développer en exportant du cannabis ».
Qu’est ce qui pousse à l’usage de drogue ?
François : « il y a des effets thérapeutiques au
cannabis »
Jacques : "Au nom de la liberté, on revendique la légalisation du
cannabis, alors que ça ne rend pas libre, puis qu’on est dépendant. La vraie
liberté n’est-elle pas de n’être dépendant d’aucune substance ?"
Antoine : « On recherche un refuge, ce n’est pas
l’idéal ».
Garçon 6e : « C’est pour fuir la
réalité »
Jacques : « Pour les indiens, l’alcool a été un
des moyens pour les assujettir ».
Différence entre légalisation : (arrêt de poursuite pour les
consommateurs) et dépénalisation (organisation d’un marché).
François : « Dépénalisation sans légalisation
c’est idiot et hypocrite : parce qu’on aux gens vous avez le droit de
consommer mais pas d’acheter ».
Pourquoi c’est si séduisant pour les jeunes ?
François : « C’est pour se taper des délires, être
joyeux, danser".
Valentin : « c’est aussi lié à la musique qu’on
écoute, c’est pour faire comme son idole ».
Mais est ce que ça fait grandir ?
mardi 15 novembre 2011
mardi 1 novembre 2011
jeudi 20 octobre 2011
Pas de café philo demain
Je serai au festival Jeunes Talents, avec un groupe de la 3ème journaliste et M. Arfeuillère donc pas de café philo... Prochain café philo vendredi 4 novembre.
Mort d’un parent : compte rendu du café philo
Pour ce café philo, on n’a pas posé de questions, on ne
savait pas comment entamer le débat sur ce sujet. On reviendra donc sur le lien parent
enfant, sur la notion d’orphelin.
Qu’est-ce que ça représente ? Comment c’est vécu à l’école ? Comment
surmonte-t-on cette épreuve ? Un élève décide de témoigner.
Nathanaël : «ça
fait 6 ans que j’ai perdu ma mère. Pendant 2 ans, après la mort de notre mère,
mes frères et moi, on ne voyait presque plus mon père. On vivait chez nos
grands-parents, c’était dur parce qu’on avait perdu notre mère et un peu aussi
notre père. A l’école, beaucoup ne comprenaient pas trop ce qui s’était passé,
parce que j’étais petit, en maternelle, et mes copains ne savaient pas ce que
c’était un suicide, même si on en avait parlé dans le journal.
Aujourd’hui j’ai eu envie d’en parler parce que ça me fait du bien de
raconter ».
Cédric : « Moi,
j’ai un ami, où la mort d’un parent s’est mal passée, car sa grande sœur lui a
reproché la mort de son père, même si son père était mort d’accident ».
Jacques : «
On peut ressentir de la culpabilité quand un parent meurt.. »
Qu’est ce qu’il
manque quand un parent meurt ?
Garçon 3ème : « C’est moins convivial, il nous manque quelque chose, on se sent
un peu différent ».
Xavier : « Les
relations avec le parent qui reste changent ».
Nathanaël : « Mon
père est devenu plus affectueux depuis la mort de ma mère. Avant, il faisait la
loi à la maison, maintenant il s’est adouci, il est moins dur ».
Karen : « Après,
ça rend la vie plus précieuse, tout peut arriver, on prend conscience que tout
peut s’arrêter du jour au lendemain. On prend conscience de la réalité de la
mort, alors on fait peut-être plus attention aux autres».
Nathanaël : « Après
la mort de ma mère, dès que mon père partait, j’avais toujours peur qu’il lui
arrive quelque chose. Je ne le quittais plus, je me sentais responsable de
lui. J’avais peur qu’il se suicide aussi ».
Fille 6ème : « On doit sentir l’absence, et on ne pense qu’à elle ».
Marielle : « On
est triste, on ne parle pas, on se sent seul ».
Karen : « ça
oblige l’enfant à quitter le monde de l’enfance plus vite, ça le fait murir, il
peut affronter la vie plus facilement car il relativise ».
Nathanaël : « Mon
grand frère qui a 15 ans, depuis que ma
mère est morte, il est plus agressif, il en veut à tout le monde. Mais il en
veut surtout à mon père à cause de ses histoires de vin, il le rend responsable de la mort de
ma mère ».
Cédric : « Certains
enfants, cherchent à combler ce manque en cherchant quelque chose ou quelqu’un
pour remplacer le parent disparu ».
Marielle : « Quand
on traverse des épreuves terribles, on est plus fort ».
Charline : « ça
peut aussi apprendre la peur, peur que ses enfants meurent quand on deviendra
parents, ou nous rendre toujours angoissés par la mort ».
Eva : « Au
début, ça affaiblit, mais avec le temps on devient plus fort. Ça permet de
relativiser nos problèmes d’ados ».
Nathanaël : « Quand
j’entends quelqu’un qui dit que sa mère le fait « chier », qu’il a
envie de la tuer, moi, je m’en vais, je ne veux pas entendre ça. Moi, je n’ai
jamais choisi ce qui est arrivé à ma mère ».
Quand un camarade
dont un des parents est mort revient à l’école…
Garçon 5ème : « ne
pas lui rappeler sans arrêt ce qui s’est passé, lui faire penser à autre
chose ».
Nathanaël : « Moi
j’aime bien qu’on en parle, mais frère lui ne supporte pas, il ne supporte pas
les photos d’elle ».
Fille 5ème : « Il faut l’aider à accepter »
Fille 6ème : « Il faut lui dire qu’il soit fort ».
Garçon : « Il
faut lui parler que s’il nous le demande. On peut le soutenir dans d’autres
domaines l’école ou être juste présent pour lui ».
Nathanaël : « quand
ma mère est morte, mes maîtresses de maternelle n’arrêtaient pas de me prendre
dans leur bras, de me faire des câlins. Mais moi, j’en avais marre, je voulais
penser à autre chose ».
Comment gérer le
souvenir de la personne disparue ?
Garçon 3ème : « Le souvenir c’est trop dur, il vaut mieux essayer d’oublier la
personne ».
Marielle : «Ce
n’est pas la même réaction si c’est une fille ou un garçon ou en fonction de
son âge. Les petits ont besoin de plus de souvenirs, car ils ont vécu moins de
choses avec elle ou ils ne se souviennent pas bien ».
Garçon 6ème : « il faut garder des souvenirs, Nathanaël garde toujours la bague et la chaine de sa
mère ».
Eva : «On n’oublie
rien, on apprend à vivre avec ».
Est-ce que nos
habitudes de deuil nous aident à accepter la mort ?
Nathanaël : «
Le jour de sa mort, ou à son anniversaire, on va tous au cimetière toute la
famille, c’est bien (sauf ma belle-mère, bien-sûr) ».
Karen : « On
peut choisir de ne pas aller à l’enterrement de ses parents, parce que c’est
trop dur ».
Dans la famille
comment le reste de la famille en parle ?
Garçon 6ème : « Il ne faut pas trop en parler, sinon ça rend triste toute la
famille ».
Garçon 4ème : « Si, on doit en parler ça fait du bien de se souvenir d’un moment
heureux avec la personne partie. Ça permet à la famille de rester soudée ».
Va : « Dans
sa famille, on doit dire ce que l’on ressent ».
« Prendre
la place » de la personne disparue
Sarah : «Les
enfants ne veulent pas qu’on remplace la personne disparue, alors ça peut créer
du conflit ».
Garçon : «
Ce n’est pas très bien de remplacer la personne disparue ».
Nathanaël : « Au
départ je voulais que mon père reste seul, puis comme j’avais peur pour lui, je
voulais absolument une belle-mère. Mais après j’ai été déçu ».
Karen : « C’est
bien que le père retrouve quelqu’un, ça l’aide. Ce n’est pas facile pour celui
qui reste de refaire sa vie. Il ne cherche pas à remplacer la personne décédée
mais il cherche à aimer différemment pour se sentir plus fort aussi pour élever
ses enfants ».
Marielle : «
L’objectif c’est de retrouver du bonheur. C’est important pour toute la
famille ».
Garçon 6ème : « Pour moi ça reste une sorte d’infidélité, je ne trouve pas ça
bien ».
Garçon 5ème : « ça dépend de la belle-mère, si
elle ne cherche pas à remplacer la mère et quelle est gentille ».
Karen : « Les
enfants n’ont pas trop envie qu’une femme remplace leur mère, mais au bout d’un
moment ils peuvent apprendre à vivre avec leur belle-mère ».
Et si les 2 parents
meurent ?
Marielle : « si
mes parents meurent tous les 2, je ne sais pas trop ce qui m’arriverait parce
que je n’ai pas de parrain et de marraine ».
Garçon 6ème : « Il vaut mieux aller chez ses grands-parents plutôt que d’aller
dans un orphelinat ou avec des gens qu’on ne connait pas ».
La manière dont on
regarde ses parents ?
Marielle : « Même
si on se dispute souvent avec notre
mère, si elle meurt on se souvient que des bons moments, on oublie les mauvais
moments ».
Jeanne : « Si notre mère meurt, on peut regretter d’avoir été plus complice
avec notre père et ne pas avoir passé assez de temps avec elle. Du coup, après
on peut en vouloir aussi à notre père ».
Anouck : « On
peut devenir aussi plus complice avec son père si avant on ne l’était
pas ».
Le souvenir d’un mort
est-ce la réalité de la personne ?
Karen : « Quand
les gens meurent, que ce soit nos parents ou autres, on améliore toujours son
image, on se souvient surtout de ses qualités ».
Garçon 3ème
: « Ce n’est pas bien de dire du mal d’un mort. Il ne peut pas se
défendre ».
Voilà, bien des pistes ont été ouvertes et si on ne prétend pas avoir
fait le tour du problème, ce café-philo restera un des plus émouvants tant
l’écoute était de qualité, tant le respect de l’autre semblait présider aux
échanges.
jeudi 13 octobre 2011
mardi 11 octobre 2011
dimanche 9 octobre 2011
L'homoparentalité en question : compte rendu du café philo
L’homoparentalité concerne aujourd’hui plus de 200000 foyers qui vivent une réalité familiale qui n’est pas reconnue par la loi : les enfants de couples homosexuels sont, au mieux, considérés comme des enfants de famille monoparentales. Pourquoi ne pas reconnaître le couple homoparental comme légitime pour élever les enfants : la question a été posée pour ce 3ème café philo de l’année.
Garçon, 6e : « J’ai une tante qui est lesbienne, elle et sa copine ont des enfants et dans ma famille c’est bien accepté. Il en a une que les petits appellent « Maman » et l’autre c’est « Mama ». C’est vrai que ça peut paraître bizarre, mais ils sont heureux ».
Garçon 6e : « C’est difficile pourtant car un enfant a besoin à a fois d’une présence masculine et d’une présence masculine ».
Et dans les familles monoparentales, n’y-a-t-il pas le même problème?
« Ça dépend si les parents sont divorcés ou pas, s’ils sont divorcés ils peuvent voir toujours les 2 parents. Et si c’est une famille monoparentale, l’enfant sait qu’un jour il a eu un papa ou une maman ».
Eva : « Il y a des choses que la mère ne pourra pas apprendre à son fils comme le bricolage et il y a des choses qu’un père ne peut pas apprendre à sa fille comme le maquillage par exemple ».
Badr : « La mère apporte plus de douceur et le père est dur ».
Karen : « ça doit être à l’école le plus dur pour l’enfant parce qu’il doit assumer les regards extérieurs. Comme par exemple pour remplir les papiers d’inscription : il y a une case pour le père et la mère… ».
Badr : « Comme les enfants d’homosexuels sont moins nombreux, ils se font mal regarder, s’ils étaient plus nombreux ça se passerait mieux ».
Aujourd’hui l’homosexualité est mieux acceptée dans la vie publique, cependant l’homophonie existe encore. La vision de l’homosexualité varie en fonction des époques et des cultures.
Fille, 6ème : « Dans un couple homosexuels, il y a toujours un plus féminin et l’autre plus masculin. Alors ça s’équilibre ».
C’est quoi une éducation féminine et une éducation masculine ?
Karen : « Une femme en général, c’est plus tendre et sa fille peut la prendre comme modèle surtout quand elle est petite. Avec son père, ça se passe mieux à l’adolescence, quand la fille part en rébellion contre sa mère, elle se rapproche de son père ».
Garçon, 6ème : « On dit qu’une femme c’est plus tendre. Moi, ma belle-mère elle n’arrête pas de crier tout le temps ».
Fille, 6ème : « Moi, j‘ai une belle-mère depuis un an et bien elle est moins proche de moi que de son enfant. Quand on n’est pas les vrais enfants on est moins proches ».
Garçon, 6ème : « Moi, mon père est devenu beaucoup plus tendre depuis le décès de ma mère, pour compenser ».
Quand on est un couple homosexuel, vaut-il mieux avoir un garçon ou une fille ?
Fille 6ème : « Les homosexuels hommes préfèrent avoir une fille, puisse qu’ils sont plus féminins et moins machos».
Et quand il y a changement de modèle ?
Fille 6ème : « Mes parents ont un ami homosexuel qui avant était avec une femme et avait des enfants mais il ne se sentait pas bien, il voulait être « normal », mais ça le rendait malheureux, alors il s’est mis avec un mec. Seulement à l’école, les autres enfants se moquent d’eux ».
Eva : « Si notre mari nous quitte pour un homme ça doit être terrible car on doit se sentir impuissante, on ne peut plus rien faire ».
Karen : «En plus si on y réfléchir après coup, ça doit être traumatisant de penser qu’il pensait aux hommes quand il était avec nous ».
Adopter un enfant pour un couple d’homosexuel est très compliqué, alors d’où vient ce désir d’enfant ? Pourquoi se compliquer la vie ?
Eva : « Ils veulent des enfants, pour être comme les autres. Pour se reconnaître comme un vrai couple ».
Karen : « C’est pour partager, et pour avoir une descendance ».
Garçon, 6ème : « Pour faire de la vie à la maison ».
Karen : « On a des enfants pour donner de l’amour ».
Garçon, 6ème : « Pour donner autre chose à sa vie. Avoir l’occasion de faire des activités avec ses enfants ».
Que veut-on transmettre à ses enfants ?
Fille, 6ème : « On veut transmettre ses gènes, son histoire, ses jouets, toutes les choses qui nous tiennent à cœur ».
mardi 4 octobre 2011
jeudi 29 septembre 2011
mardi 27 septembre 2011
jeudi 22 septembre 2011
lundi 19 septembre 2011
Vidéo de Lhomé : amoureux d'un ange
http://www.youtube.com/watch?v=ddmaGbB6BO0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=ddmaGbB6BO0&feature=related
dimanche 18 septembre 2011
Lhomé au café philo : atelier slam et débat
Extraits :
"Je m'appelle Julien Laba, mon nom de scène, c'est Lhomé. Je suis slameur depuis 3ans et rapeur depuis 10 ans. Avant je faisais partie d'un groupe de rap, Slave farm, avec qui j'ai fait 3 albums et plusieurs tournées."
"Ecouter de la musique c'est important, parce que la musique appartient à notre culture. Il faut être ouvert et curieux parce que si vous ne mangez que ce qui passe à la télé, vous allez passer à coté de beaucoup de choses. Il faut savoir être curieux, et écouter encore et toujours".
"L'inventeur du slam, c'est Marc Smith, un ouvier du Bâtiment qui adorait la poésie mais qui déplorait son manque d'énergie et chercher un moyen de la faire connaitre, parce que la poésie ne devaient pas être réservée aux grosses têtes. Il a donc imaginé une joute entre poétes qui se passerait dans un bar. Slam signifie "claquer", c'est un sport de poésie. La seule règle du slam, c'est être a capella, c'est à dire sans l'accompagnement d'un instrument musical"
Exercice de rime : "La rime n'est qu'un élèment du texte, ce que est important, c'est le sens. Pourquoi j'écris, qu'est ce que j'ai à dire ?".
Pour moi dire un texte de rap, c'est comme un match de boxe alors que le slam, c'est plus une caresse".
lundi 12 septembre 2011
mercredi 22 juin 2011
Bilan du café philo sur la photographie
On prend tous des photos, avec nos portables et avec le progrès technique (comme le numérique), on peut même en prendre de façon illimitée. Mais la photographie, ce n’est pas seulement une technique, c’est aussi un art. Quel sens ça peut avoir de prendre des photographies pour d’autres raisons que la conservation des souvenirs ou la conservation d’images de soi ? La photographie a-t-elle vocation de représenter le réel, peut-elle d’ailleurs représenter le réel ?
Pourquoi prend-t-on des photos ?
Marion : « Pour garder des souvenirs des gens et ou des paysages qu’on aime. »
Florentin : « C’est pour se remémorer les sentiments qu’on avait devant les yeux ».
Xavier : « Parfois il y a des photos mal faites : sourires trop artificiels, on ferme les yeux… ».
Victor : « La photo nous procure un sentiment seulement pour soi-même, comme par exemple quand on connait les gens sur la photo ou elle nous rappelle un contexte particulier ; c’est quelque chose d’intime ».
Ophélie : « Parfois, la photo ment, parce que c’est une mise en scène, on triche avec la vérité ». Marie : « j’ai en tête une photo floue qu’on a prise en voyage scolaire, mais elle est magnifique car elle retranscrit un moment où on rigolait. Elle est floue mais elle est plus vraie que nature. Elle représente la joie et la complicité du groupe».
Qu’est ce qui fait une bonne photo ?
Marie : « Ce qui attire le photographe, c’est un moment précis. Elle décompose le mouvement ».
Paola : « Parfois elle nous révèle une réalité qu’on ne connait pas ».
Séverine : «ça fige un moment unique qui ne se reproduira pas ». « Il n’y a pas vraiment de règle, il faut que la photo touche. Parfois, on voit des images bien réalisées avec de belles proportions, mais qui laissent froid».
Antoine : « Dans mes cours de combat, mon prof a utilisé une photo pour nous montrer un mouvement que le réel ne permettait pas de montrer».
Victor : «Il ya un photographe, [Muybridge] célèbre pour ses décompositions photographiques du mouvement et grâce à ses photos, il a pu prouver que le cheval au galop voit ses jambes se décoller du sol ».
Jacques : « La photographie peut donc révéler une vérité scientifique ».
La photo de famille peut-elle être une photo d’art ?
Maxence : « Non, c’est personnel, ça ne concerne que la famille ».
Marie : « Au départ ce n’est pas une photo d’art, mais ça peut le devenir ».
C’est quoi une œuvre d’art ?
Victor : « C’est quelque chose de nouveau, d’inédit ».
Florentin : « Une œuvre d’art c’est l’expression d’un sentiment. Une œuvre d’art nous met en mouvement… »
Marie : « Une photo de famille ça peut nous rappeler le passé, faire parler l’époque. C’est indiscret mais ça peut nous apprendre des choses ».
Qu’est ce qui est magique dans la photographie ?
Ophélie : « La photographie fixe un instant qui ne se reproduira plus, sur une photo on est un peu éternel ».
Florentin : « La photographie existe dans notre regard, on la regarde avec ce qu’on a dans la tête ».
Jacques : « Le grand photographe, nous piège dans son histoire, on récrée du réel ».
Pourquoi prend-t-on des photos ?
Marion : « Pour garder des souvenirs des gens et ou des paysages qu’on aime. »
Florentin : « C’est pour se remémorer les sentiments qu’on avait devant les yeux ».
Xavier : « Parfois il y a des photos mal faites : sourires trop artificiels, on ferme les yeux… ».
Victor : « La photo nous procure un sentiment seulement pour soi-même, comme par exemple quand on connait les gens sur la photo ou elle nous rappelle un contexte particulier ; c’est quelque chose d’intime ».
Ophélie : « Parfois, la photo ment, parce que c’est une mise en scène, on triche avec la vérité ». Marie : « j’ai en tête une photo floue qu’on a prise en voyage scolaire, mais elle est magnifique car elle retranscrit un moment où on rigolait. Elle est floue mais elle est plus vraie que nature. Elle représente la joie et la complicité du groupe».
Qu’est ce qui fait une bonne photo ?
Marie : « Ce qui attire le photographe, c’est un moment précis. Elle décompose le mouvement ».
Paola : « Parfois elle nous révèle une réalité qu’on ne connait pas ».
Séverine : «ça fige un moment unique qui ne se reproduira pas ». « Il n’y a pas vraiment de règle, il faut que la photo touche. Parfois, on voit des images bien réalisées avec de belles proportions, mais qui laissent froid».
Antoine : « Dans mes cours de combat, mon prof a utilisé une photo pour nous montrer un mouvement que le réel ne permettait pas de montrer».
Victor : «Il ya un photographe, [Muybridge] célèbre pour ses décompositions photographiques du mouvement et grâce à ses photos, il a pu prouver que le cheval au galop voit ses jambes se décoller du sol ».
Jacques : « La photographie peut donc révéler une vérité scientifique ».
La photo de famille peut-elle être une photo d’art ?
Maxence : « Non, c’est personnel, ça ne concerne que la famille ».
Marie : « Au départ ce n’est pas une photo d’art, mais ça peut le devenir ».
C’est quoi une œuvre d’art ?
Victor : « C’est quelque chose de nouveau, d’inédit ».
Florentin : « Une œuvre d’art c’est l’expression d’un sentiment. Une œuvre d’art nous met en mouvement… »
Marie : « Une photo de famille ça peut nous rappeler le passé, faire parler l’époque. C’est indiscret mais ça peut nous apprendre des choses ».
Qu’est ce qui est magique dans la photographie ?
Ophélie : « La photographie fixe un instant qui ne se reproduira plus, sur une photo on est un peu éternel ».
Florentin : « La photographie existe dans notre regard, on la regarde avec ce qu’on a dans la tête ».
Jacques : « Le grand photographe, nous piège dans son histoire, on récrée du réel ».
Inscription à :
Articles (Atom)